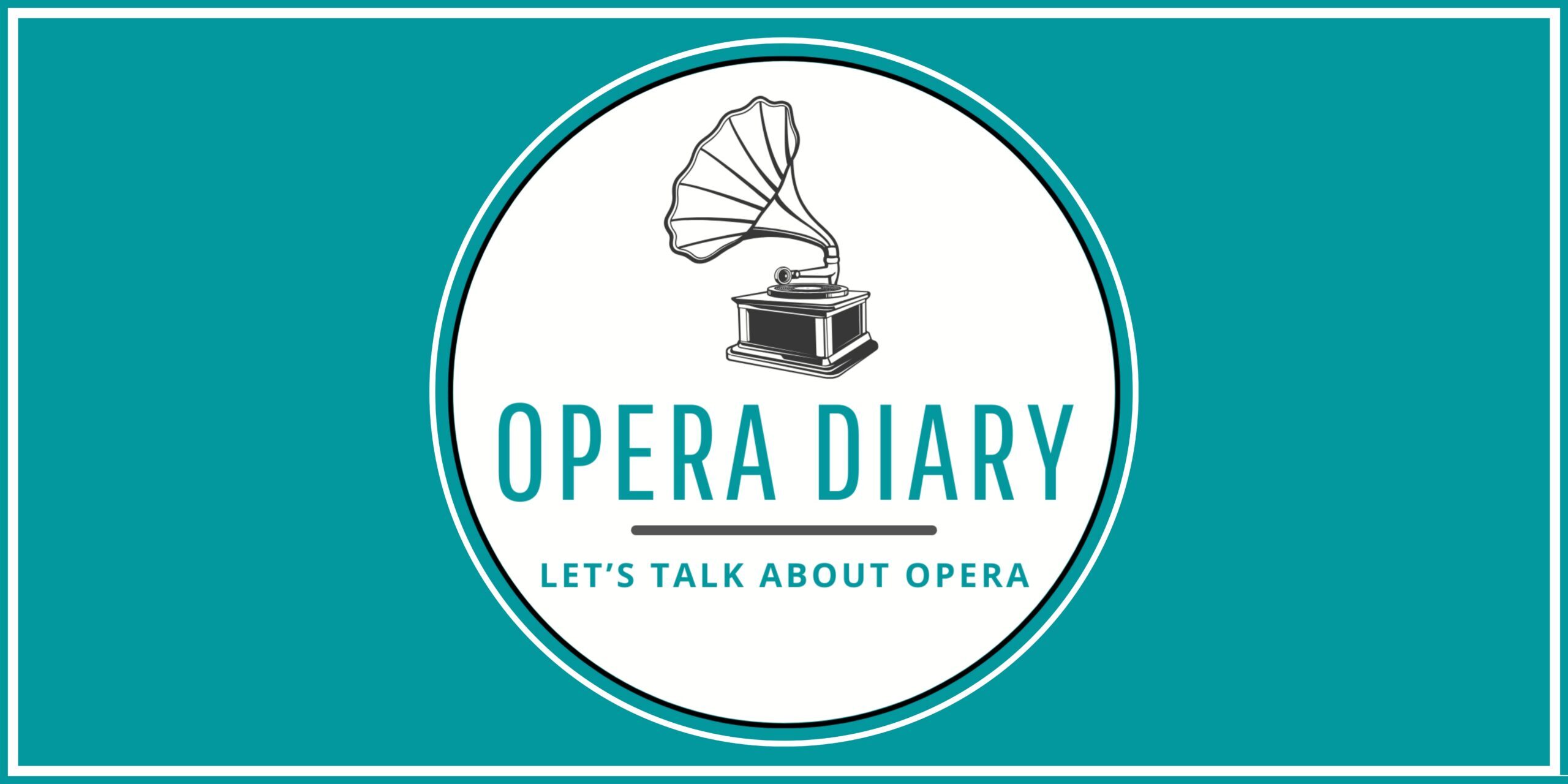Tout s’est fait en moins de 48 heures. Il a quand même fallu une petite relance : ses activités l’obnubilent – notamment sa traduction de Shakespeare en polonais – mais ne l’ont pas empêché de nous donner son accord chaleureux pour cette entrevue. Deux semaines avant la prise de contact, nous ne croyions que modérément à une réponse positive. La période estivale s’approchant à grands pas, ses engagements, son sens des priorités placé certainement ailleurs que sur un groupe de jeunes gens n’ayant pour carte de visite qu’un amour fou pour l’art lyrique… Trop d’éléments qui ne jouaient pas vraiment en notre avantage. Quelle ne fût donc pas notre surprise à la réception d’un “oui” plein de générosité à notre requête.
Ce que nous voulions ? Récolter des informations permettant de lui consacrer un portrait. Il s’agit tout de même du seul auteur en vie ayant eu le culot de rédiger un ouvrage dont le titre dénonçait l’ambition de l’entreprise : Mille et un opéras. Lieu du rendez-vous ? Là où cela l’arrangerait. Nous étions prêts à faire la campagne de France pour lui serrer la main et faire connaître notre admiration pour ce qu’il a fait – et fait encore – pour l’opéra, à l’antenne comme dans la presse écrite.
Le lendemain, destination Provins. Nous ne connaissions que mal cette ville de l’est parisien. Météo quelque peu renfrognée, pas vraiment exaltante. Passons outre : le personnage est haut en couleurs, une véritable encyclopédie de souvenirs, partagés avec un brin de malice enfantine que le regard vif et le sourire facile dénoncent. Car Piotr Kamiński se livre avec une bienveillance qui déconcerte quand on l’interroge sur les évènements vécus, les chemins parcourus, ces mille et un instants qui, unis de bout à bout, ont édifié une vie dont les rebondissements ont quelque chose d’opératique. Récit en 6 actes.
Acte I : Que ça se termine bien !
Très tôt les graines d’opéra ont été lancées dans ce terrain qui s’avéreraient des plus prolifiques. La seule condition imposée : que les histoires se terminent bien.
Grâce au métier de son père, l’historien Andrzej Józef Kamiński, amené à se rendre régulièrement en ex-RDA, il se nourrissait des 45 tours disponibles, avant que la disquaire du coin ne le prenne en sympathie et ne lui vende les meilleurs enregistrements, soigneusement cachés : Maria Cebotari dans E Susanna non vien… Dove Sono, Tiana Lemnitz en Octavian et la même Cebotari en Sophie dans Mir ist die Ehre widerfahren du Rosenkalier… Le répertoire était certes étroit, mais n’attendait que son temps pour s’élargir, et on sait jusqu’où (et à quel prix).
Mais le disque, c’est le luxe d’une période qui n’était pas encore arrivée, ascension et déclin dont il a été un témoin privilégié. Au tout début, c’est la radio qui offrait à l’enfant Piotr les merveilles de cet âge d’or : Gräfin Mariza de Kálmán, les Rossini de l’époque (Barbier, Cenerentola)… Et la musique classique ensuite, Mozart en tête de gondole (il sera beaucoup question du prodige salzbourgeois dans le parcours de notre portraituré).
Dès le début, il savourait avec une identique ivresse la beauté des voix et l’enchantement de la musique instrumentale. A cela rajoutez un engouement passionné pour le théâtre, né au même moment que ses premières découvertes lyriques. Pas une seule première aux théâtres de Poznań sans que Piotr et ses copains du lycée n’y soient. Tout feu, tout flamme qu’il était, il a même songé à entamer une carrière en tant que chef d’orchestre (formation musicale à l’appui), puis comme metteur en scène. Que l’on incrimine le destin ou autre, c’est vers la philologie romane, à Varsovie, qu’il s’est orienté.
Acte II : Entre variétés françaises et l’écho du Vatican
C’est dans la capitale polonaise que ses premières expériences radiophoniques – désormais en tant qu’animateur d’émissions – ont eu lieu. Émissions, car elles ont été nombreuses à s’enchaîner sur 14 ans d’activité.
La programmation proposée ? Point de Vivaldi ou Tchaïkovski. Anthologie de la chanson française. La traduction y était déjà, et le travail faramineux des intégrales, sous un format différent de celui entamé quelques années plus tard quand il sera installé en France, pointait déjà le bout de son nez : Brassens, Barbara, Brel, et tant d’autres. Ce qui l’attirait, c’étaient les voix un peu marginales, moins répandues auprès du grand public. Question de sensibilité à leur beauté singulière et à celle du texte qu’elles véhiculaient. L’attachement à l’irréfutable importance du texte et de l’union inaliénable du mot à la note s’exprimait d’ores et déjà, pierre angulaire qui n’aura pas cédé sa place au cours de plus de 40 ans de carrière.
Soudain, une date fait irruption dans son récit. 16 octobre 1978. Pour un européen né du côté ouest du rideau de fer, peu de chances qu’elle éveille un quelconque souvenir. Il en va tout autrement pour un Polonais. Car l’élection du premier pape polonais (premier pape non italien tout court depuis le XVIe siècle) n’est pas un épisode de piètre importance. Il garde un souvenir ému de cette journée, il narre la scène comme s’il la suivait des yeux : il se trouve dans le salon. A l’annonce de l’élection de Karol Wojtyla, il court vers la cuisine, regarde, éberlué, son épouse. Ils se disent que cela ne peut être vrai, et pourtant ça l’est. Ils ne se doutent pas un instant que ce n’est que le début d’une série d’évènements qui décideront de leur destin, du leur et de celui de chaque Polonais.
Pour que l’on prenne la mesure du séisme que la nomination de Jean-Paul II a représenté, il faut se pencher sur les faits qui se sont déroulés après ce point de bascule. Épouvante au sein du régime communiste de la République populaire de Pologne. Quelques mois après, Jean-Paul II entame pour la première fois après son élection un pèlerinage apostolique chez les siens. Ce qui a marqué au fer le souvenir du jeune Piotr, c’est la messe du 10 juin 1979 à Cracovie, dans cette immense prairie, espèce de Hyde Park cracovien, réunissant une foule qui se comptait en millions et à qui ce diplomate en soutane s’adresse en des termes pour le moins téméraires : L’homme choisit consciemment, dans sa liberté intérieure. Tous les correspondants étrangers y étaient, et Piotr observe, dans les studios de la Radio Polonaise, les plans généraux qui leurs cameramen captaient avant de les envoyer vers leurs patries d’origine, mais jamais transmis à la télé polonaise.
Pas un seul incident majeur n’a été déclaré lors de cette visite qui s’est pourtant révélée le début d’une révolution dont les premiers faisceaux ont resplendi au cours des mois suivants. Explosions des grèves côté peuple, répression côté gouvernement, avec Dieu seul sait combien de manœuvres qui ne dénonçaient qu’une trouille inavouable du régime. Proposition d’accords côté syndicats (pour certains signés), violations côté régime. Sans la venue de Karol Wojtyla, et une croyance inébranlable dans une protection venant d’ailleurs, le Piotr d’aujourd’hui assure que les choses ne se seraient pas passées ainsi. Autrement, comment expliquer pareille audace confinant à la bravoure, capable de pousser des milliers de grévistes à mettre à l’arrêt un pays tout entier sous le joug de la répression communiste ?
Le gouvernement, acculé, cède sur tous les fronts : la signature des accords de Gdańsk autorisant la création de syndicats autogérés fédérés au sein du Solidarność (« Solidarité »), dirigé par Lech Wałęsa, couronne de succès ces premiers combats. Aussitôt créé, aussitôt profané : on accuse Solidarność de vouloir instaurer un double pouvoir et, comble de l’abomination, l’anarchie. Non sans mal Wałęsa essaye de contrôler ses partisans. La tension monte jusqu’à la dispersion brutale d’une réunion de Solidarność, suivie d’une grève d’avertissement en mars 1981. Point de non-retour pour le gouvernement, qui menace d’instaurer la loi martiale si l’ordre de grève générale est maintenu. Un compromis de dernière heure est trouvé le 30 mars 1981, ce dont Wałęsa ne sera jamais pardonné. Ni lui, ni Ronald Reagan : ce même jour, une tentative d’assassinat est perpétrée contre le président américain à l’hôtel Hilton de Washington. En mai 1981, c’est au tour du souverain pontife d’être victime d’une tentative d’homicide, place Saint-Pierre. Piotr en convient, les liens entre ces différents évènements sont bien plus sibyllins et délicats qu’on ne le croit, mais ce qui s’est joué en Pologne a indéniablement projeté son empreinte sur la toile géopolitique d’alors.
Acte III : Paris (surtout) & ailleurs
Tout le remous que traverse la société polonaise n’empêche pas les répétitions d’Amadeus, pièce signée Peter Shaffer et mise en scène par Roman Polanski, de commencer en juin 1981 dans un théâtre de Varsovie. C’est par l’intermédiaire d’un copain que Piotr est présenté et proposé en tant que conseiller musical au metteur en scène franco-polonais qui, après la première, l’enjoint de l’accompagner en France pour la production parisienne.
Ce sera son quatrième séjour à Paris, à partir duquel il s’installe dans la capitale. Le premier date de 1967. Le deuxième a lieu en 1973 (en tant que journaliste de RFI) et, sur celui-ci, les yeux pétillants, il ouvre une parenthèse. Car ce séjour coïncide avec la première saison de Rolf Liebermann à la tête d’un Opéra de Paris mal en point depuis quelques années. Le vent pompidolien (en beaucoup favorisé par la grande mécène qu’était Claude) lui permettra de connaître une nouvelle ère. Piotr s’enflamme en se souvenant des fastes de cette période : l’administrateur général, ayant dissolu la troupe fixe, réunit des distributions étincelantes – à peine exagère-t-il en disant que c’était l’année du tout ou jamais : Elektra avec, excusez du peu, Birgit Nilson dans le rôle-titre, Christa Ludwig en Klytämnestra et Leonie Rysanek en Chrysothemis, mise en scène d’August Everding, Karl Böhm dans la fosse avec l’Opéra National de Paris ; Le Nozze di Figaro mis en scène par Giorgio Strehler, direction de Georg Solti, toujours avec l’Opéra National de Paris et Tom Krause en Figaro, Gabriel Bacquier en Conte, Margaret Price en Contessa, Lucia Popp en Susanna et Teresa Berganza en Cherubino.
Hélas, le festin n’aura été que de courte durée : après le décès foudroyant de Pompidou et l’élection de Giscard d’Estaing, les bonnes relations que Liebermann a habilement entretenues avec l’Élysée se voient quelque peu distendues. Le coup de grâce : la coupure de courant (accidentelle) durant une représentation d’Elektra à laquelle Giscard avait invité son homologue ouest-allemand Helmut Schmidt, plongeant la salle dans l’obscurité pendant plusieurs minutes. Électricité rétablie, opéra repris et donné jusqu’au bout, mais l’irréparable est commis : la brouille entre Giscard et Liebermann entachera à jamais leur relation. De cette période opulente, deux souvenirs thaumaturgiques : le moment où Margaret Price, Contessa mémorable, reprenait pianissimo Dove sono et Vladimir Ashkenazy et Daniel Barenboim au TCE, jouant le Concerto pour deux pianos n° 10 de Mozart.
Le troisième séjour se déroule en 1979. Armé d’un “ordre de mission” par lui-même fabriqué, mais estampillé par la Radio Polonaise, il revient en France, pour revoir Le Nozze de Strehler, puis découvrir, à Aix, ceux de Jorge Lavelli sous la direction lumineuse de Neville Marriner. Il ne s’arrête pas là : Arènes de Vérone, Venise (pour 2 concerts avec Abbado, dit-il taquin, avec Margareth Marshall, incomparable dans la Cantate BWV 51 de Bach) et Salzbourg. Pas de billets pour assister aux représentations du festival ? Qu’à cela ne tienne : son “ordre de mission” providentiel le désignant comme le correspondant culturel de la Radio Polonaise lui permettra de tout voir, tout écouter. Un souvenir de cette expérience ? Il nous en propose deux : l’Ariadne auf Naxos mis en scène par Dieter Dorn, avec Hildegard Behrens (Ariade/Primadonna), Edita Gruberová (Zerbinetta) et Trudeliese Schmidt (Komponist), sous la direction de Karl Böhm qui vient de fêter ses 85 ans. Au milieu du spectacle, il sent que ça ne va pas du tout. 40 °C de fièvre, un épuisement qui ne lui laisse d’autre choix que de rentrer. Nuit épouvantable, à la suite de laquelle il retourne au bureau de presse qui vient à sa rescousse et l’envoie chez un médecin – kostenlos, natürlich – qui lui administre une piqûre, salutaire, et grâce à laquelle dès le lendemain, il pourra rentrer à Varsovie, frais comme une rose…
Il atterrit à Paris pour son quatrième séjour le 23 novembre 1981. Les répétitions d’Amadeus démarrent. On l’envoie aux Pays-Bas chercher, chez Philips, les plages musicales du futur spectacle. Il regagne la capitale le 5 décembre. Le 13, à 6 heures du matin, le général Jaruzelski proclame en Pologne la loi martiale (il l’appelle l'”état de guerre”, traduction littérale de stan wojenny). Coup de semonce que la presse étrangère qualifie naïvement de coup de théâtre, mais qui amorce la mécanique visant à museler les Polonais et à les assujettir à l’isolement le plus anxiogène qu’ils auront connu dans leur histoire contemporaine. Cadres et militants de Solidarność arrêtés et internés dans des camps, toute manifestation interdite sans autorisation préliminaire, sortie et rassemblements défendus, couvre-feu et censure instaurés, colonnes des tanks dans les rues, et tout entretien téléphonique accompagné d’un refrain préenregistré : “conversation contrôlée”. Aucun signe de ce qui se passe au-delà des frontières aériennes et terriennes ne parvient à ceux qui, comme Piotr, ont pu partir avant. Grand concours de circonstances quand il y pense : que serait-il advenu si, pour une quelconque raison, son départ avait été retardé ? Le sort de tant de personnes aura été bouleversé par le fait d’avoir, cette nuit, et par hasard, traversé la frontière dans la bonne ou la mauvaise direction. Pas de place ici pour l’uchronie, mais la question le laisse songeur.
Acte IV : Le casque et la plume
En décembre 1981, François Mitterrand, alors fraîchement élu, met en exécution l’une de ses promesses de campagne : ressusciter les émissions en langue étrangère diffusées à l’ORTF (dont RFI faisait partie), supprimée par Giscard en 1975.
Avant sa dissolution, une cellule chargée de la réalisation d’émissions d’une demi-heure par jour adressées à la minorité polonaise habitant le Nord de la France a été créée au sein de la RFI. Contre toute attente, cette section a survécu à l’éclatement de l’ORTF et est devenue le point de chute de Piotr, et ce pour plus de 25 ans. Concomitamment à son engagement chez RFI et en tant que conseiller musical pour des pièces de théâtre, il garde un œil attentif sur ce qui se passe sur la scène lyrique parisienne qui tourne à plein régime, sous l’égide de Bernard Lefort, Massimo Bogianckino, Jean-Louis Martinoty…
A cette période il entame son activité en tant que critique musical dans l’Avant-Scène Opéra. Sa première critique : Falstaff, apparu en 1982 chez Deutsche Grammophon et dirigé par Carlo Maria Giulini. C’était le début d’une très longue collaboration qu’il l’a relié à cette revue, dirigée d’abord par Alain Duault, puis, des années durant, par Michel Pazdro – et qui fait toujours référence dans le milieu.
A partir de 1983, il intègre France Musique. Sa mission, dès 1984 : animer la matinale. De cette expérience, ses souvenirs, sans aucune fausse modestie, ne sont pas les plus flatteurs à son propre endroit : j’étais trop jeune et trop bête. J’aurais dû la faire de façon infiniment plus sérieuse. Il sera remplacé dès 1985, ce qui le pousse à revenir à RFI, à un moment où le public de France Musique accable la rédaction de lettres réclamant le retour de la Tribune des critiques de disque, créée en 1946 par Armand Panigel et supprimée entre-temps par le directeur René Koering. En réaction au mécontentement des auditeurs, Désaccords parfaits, animé par Jean-Michel Damian, arrive à l’antenne. L’émission est exquise, associe des écoutes comparatives à d’autres sujets aussi variés qu’éloignés du monde musical, fait intervenir un noyau de fidèles renouvelé à chaque numéro (Piotr en fait partie). Bientôt, cependant, l’ancienne formule revient à l’antenne, d’abord sous le titre A bon entendeur, salut, puis, en 1997, en tant que Tribune de France-Musique. Gérard Courchelle en est l’animateur, et c’est à son invitation que Piotr reprend cet exercice quelque peu insolent que le format impose.
Auparavant toutefois, vers la fin des années 1980, il avait été recruté par Georges Cherière qui lançait une nouvelle revue, Répertoire des disques compacts, mensuel embrassant l’ensemble du paysage discographique classique. Peu de temps après, une crise éclate dans la rédaction qui l’incite à étudier sérieusement la possibilité de lancer une nouvelle revue musicale. Avec Jean-Charles Hoffelé, ils préparent un dossier très solide. Des pourparlers se poursuivent, de plus en plus sérieusement, avec des Italiens, des Néerlandais… mais le projet n’aboutit pas. C’est alors que Yves Petit de Voize lui donne la possibilité de rejoindre Diapason.
Acte V : Années de pèlerinage
Dès les années 1990, encouragés par Jean Nithart, directeur financier des Editions Fayard, et qui tient les reins du formidable catalogue des éditions Fayard, Jean-Charles Hoffelé et Piotr Kamiński se lancent dans l’élaboration des Indispensables du disque compact classique. Une véritable mine d’informations, avec le souci de l’exhaustivité que l’époque leur permettait. A ce travail, en soi déjà assez colossal, se sont ajoutées ses contributions aux trois Guides des opéras (toujours chez Fayard) : Wagner (1988), Verdi (1989) et Mozart (1991), sous les directions respectives de Michel Pazdro, Jean Cabourg et Brigitte Massin.
C’est alors que Jean Nithart lui lance l’idée de travailler sur un nouveau “guide lyrique”. L’idée ne lui était pas étrangère : à l’époque, le dernier guide polonais de ce type, datant des années 1960, réunissait quelque 200 titres. Avec l’explosion du répertoire stimulée par le disque, l’ouvrage se trouvait plus que dépassé. Piotr lui fait donc la contre-proposition et Jean Nithart l’invite à concevoir le livre en français.
Le nom du livre ? Vite trouvé : Mille et un opéras. Le schéma de travail ? Une liste de titres bâtie à deux, avec pas mal d’allers-retours et de concessions de part et d’autre pour que, une fois l’ébauche achevée, Piotr se lance – seul – dans le chantier. En commençant par les plus connus : Haendel, Mozart, Verdi… La suite, il verrait bien comment cela se présenterait. Jedes Ding hat seine Zeit.
Démarrage des travaux en 1995, dans la plus grande discrétion. Personne, hormis son épouse, un ami musicologue et Jean Nithart, n’était au courant de l’affaire, car il ne se croyait pas capable de la mener à bien. Mieux valait le silence que le ridicule.
La traversée de Rubicon a eu lieu une fois la partie consacrée à Richard Strauss finalisée : je me suis soudain dit, les autres, ça ira ! Pas de raison bien précise à cela, mais vu que Strauss n’apparaît qu’à la fin du bouquin (si tant est qu’il l’ait rédigé en ordre alphabétique), il se peut qu’il ait mis beaucoup de temps avant de se dire que ça irait vraiment.
Fort de l’expérience des Indispensables du disque compact classique, il a ingénument cru que la rédaction du Mille et un opéras ne lui prendrait pas plus de 3 ans. Le livre n’apparaîtra que fin 2003 (la version polonaise a été publiée en 2008) avec, au lieu des 500 pages initialement stipulées dans le contrat, 1829, deux colonnes par page, police 10. Pendant 8 ans, il s’est immuablement levé le matin, consacré l’essentiel de ses journées à ses recherches et à la rédaction de l’ouvrage et s’est couché, tel un moine dans sa cadence ascétique, sans déroger à sa routine. La grosse différence entre Les Indispensable et le Mille et un ? L’accès aux ressources, autrement plus difficile pour le second que pour le premier.
Non content de la difficulté de base de sa tâche, il s’en est imposé une autre : avoir les distributions d’origine. Dans certains cas, ce sont des efforts à la Prométhée qu’il a dû accomplir pour aller jusqu’au bout de ce qu’il concède avoir été un petit caprice (il garde toujours deux volumes d’une publication universitaire tirée à la polycopieuse à l’alcool…). Pas moins de trois visites aux archives de l’opéra de Paris assisté d’un archiviste ont été nécessaires pour qu’il établisse, le premier, la distribution d’origine de Lodoïska de Luigi Cherubini à l’Opéra de Paris. Quand les épreuves sont arrivées pour les corrections, son domicile a été pris d’assaut par des piles plus hautes que lui de papier 80 g imprimés uniquement côté recto.
Le résultat de cette mission herculéenne ? Une œuvre qui se distingue à mille lieues des autres du genre, par une quantité prodigieuse d’informations, une prose recherchée, une structure on ne peut plus simple, dont les lecteurs francophones et polonais peuvent revendiquer, non sans fierté, d’être le seul livre apparu après 2000 recensant tout ce que tout mélomane souhaite connaître.
Sa partie préférée ? Là où, selon ses termes, il se lâche : dans le paragraphe “œuvre”, où il n’est jamais à court d’anecdotes. Le meilleur résumé (preuve qu’il faut l’abréger, ce bouquin, car je me suis vraiment laissé aller !) : Les aventures du roi Pausole, d’Arthur Honegger (pp. 681-684), opéra légèrement pornographique, hélas trop peu connu. Un regret ? Ne pas avoir fait tous les Savoy operas de Gilbert et Sullivan, duo musical emblématique de l’époque victorienne.
A ceux qui, comme lui, ne disent pas non aux missions d’envergure : sachez qu’il y a un, et un seul piège dans le livre, laissé volontairement par son auteur, justement dans l’une des fameuses distributions. Depuis plus de 20 ans personne ne l’a remarqué. Avis aux amateurs…
Acte VI : Opéra hier, opéra aujourd’hui… et demain ?
Impossible de clore ce portrait sans recueillir son avis sur les opéras contemporains. Pourront-ils s’imposer comme des œuvres du répertoire ? Il répond avec la franchise que son expérience l’autorise : seule l’épreuve du temps pourra démontrer, ou non, leur assise. Et la tâche n’est pas des plus ordinaires : sans circonlocutions, il affirme qu’après la création de Turandot, l’opéra en tant qu’art populaire a été remplacé par le cinéma (Tosca, ça se voit comme un film, vous ne trouvez pas ?).
Sans tomber dans la provocation, il nous invite à considérer le cas de la comédie musicale. Pour lui, pas de surprise à considérer (constater ?) que la cadette remporte la préférence du public vis-à-vis de son aînée. Le constat peut être amer, mais est irréfragable : chez le grand public, il n’y a guère de comparaison possible aujourd’hui entre l’effervescence que Broadway suscite et celle que génère la Scala.
Une explication à cela ? Pas de réponse prête à l’emploi, mais il faut se souvenir que l’opéra, c’est avant tout du théâtre. Partant de ce corolaire, à bien examiner de près, comptez sur le concours de bon nombre d’éléments pour que le miracle “opéra” s’accomplisse : talent musical avéré, parfaite compréhension du texte (il faut que ça touche chez le spectateur le cœur et l’esprit au même moment), création et maintien du lien indéfectible agrégant texte et musique jusqu’à ce qu’ils n’en fassent qu’un.
Il lance le défi : parmi les opéras contemporains, désignez un seul dont l’un des morceaux soit capable de vous imprégner jusqu’à ce qu’il devienne fredonnable. “Rien n’égale la puissance d’une mélodie, sinon celle d’une phrase parfaite“. Si on poursuit la réflexion, l’évidence s’impose : reproduire aussi fidèlement que possible le contenu de l’œuvre n’est pas l’enjeu. Le but est de lui donner corps et chair pour que le public croie, sans réserve, au récit qui habite la scène – surtout celui ou celle qui n’a jamais pénétré un théâtre, pour qui chaque bout de mélodie, chaque mesure est une révélation, jusqu’à ce qu’il ou elle ne rêve que d’y retourner.
Le dernier grand compositeur d’opéra capable de bouleverser le public ? Britten. Depuis, des efforts ont été faits, mais le résultat n’est pas encore celui pouvant garantir que l’opéra restera un art accessible à un large public. De deux options, une : soit on apprendra à fredonner cette musique pour beaucoup abstraite, soit on finira par comprendre, après toutes les innombrables expériences pratiquées depuis plus d’un siècle, que l’être humain ne marche qu’à la musique tonale.
Perte de temps que de s’évertuer à vouloir fabriquer du faux neuf avec du vieux : que Desdemona tue Otello, Carmen crève les yeux de Don José ou autre ne suffira pas à attirer celui qui n’a jamais mis les pieds dans un opéra. Inutile aussi de porter atteinte aux jumelages absolus sous prétexte de bonnes intentions : des merveilles comme celles conçues par Da Ponte et Mozart, Boito et Verdi, Hofmannsthal et Strauss, on les respecte, révérence que l’on pratique aussi en renonçant à l’idée de greffer des perceptions incongrues à des récits sacralisés par le temps.
Il n’est pas complètement optimiste, sans pour autant être pessimiste. Il scrute le chemin que l’opéra prend et reste attentif à ce qu’il deviendra, partage ses avis, récolte ceux des autres, entretien le débat, s’alimente avec. Pas d’autre choix possible chez cet enthousiaste que de suivre cette évolution avec l’intérêt et la passion qui ont toujours jalonné son parcours, dont les prochains virages pourront bien nous surprendre. Une nouvelle édition du Mille et un opéras ? Sa traduction en anglais ? Il ne dit pas oui. Sans aller jusqu’à dire non…
Livres
| Titre | Année | Editeur |
| Guide des opéras de Wagner (sous la direction de Michel Pazdro) | 1989 | Fayard |
| Guide des opéras de Verdi (sous la direction de Jean Cabourg) | 1990 | Fayard |
| Guide des opéras de Mozart (sous la direction de Brigitte Massin) | 1991 | Fayard |
| Les indispensables du disque compact classique (avec Jean-Charles Hoffelé) | 1993 (réédité en 1994 et 1995) | Fayard |
| Les bonnes affaires du disque compact classique | 1996 | Fayard |
| Mille et un opéras | 2003 | Fayard |
| Le Bel Canto : Rossini, Bellini, Donizetti… (issu du Mille et un opéras) | 2010 | Librairie générale française (Le livre de poche) |
| Haendel, Purcell et le baroque à Londres (issu du Mille et un opéras) | 2010 | Librairie générale française (Le livre de poche) |
| Lully, Rameau et l’opéra baroque français (issu du Mille et un opéras) | 2011 | Librairie générale française (Le livre de poche) |
| Richard Strauss et le post-romantisme allemand (issu du Mille et un opéras) | 2011 | Librairie générale française (Le livre de poche) |
| Les 101 grands opéras | 2014 | Pluriel |
| Tysiac i jedna opera | 2015 | Polskie Wydawnictwo Muzyczne |
Crédit de la photo de couverture: ©Grzegorz Śledź/PR2